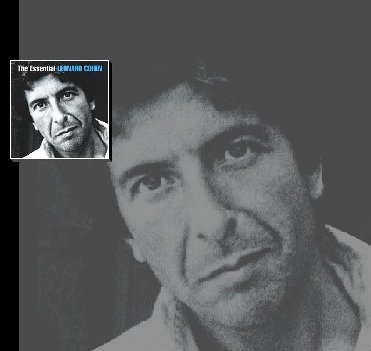Il est tout de même étrange qu'en se réveillant le matin on retrouve tout, du moins en général, exactement à la même place que la veille. On a été pourtant dans le sommeil et dans le rêve, dans un état tout différent de celui de l'homme éveillé, et il faut une présence d'esprit infinie, un sens étonnant de la riposte, pour situer tout ce qui est là, dès qu'on ouvre les yeux, à la même place que la veille. Aussi le moment du réveil est-il le plus risqué de la journée et une fois ce moment surmonté sans qu'on ait été changé de place on n'a plus à s'inquiéter le reste du jour.
|
...........
Claude Nougaro
Ô Toulouse
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin
Parfois au fond de moi se raniment
L'eau verte du canal du Midi
Et la brique rouge des Minimes
O moun païs, ô Toulouse, ô Toulouse
Je reprends l'avenue vers l'école
Mon cartable est bourré de coups de poing
Ici, si tu cognes, tu cagnes
Ici, même les mémés aiment la castagne
O moun païs, ô Toulouse
Un torrent de cailloux roule dans ton accent
Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes
On se traite de con à peine qu'on se traite
Il y a de l'orage dans l'air et pourtant
L'église Saint Sernin illumine le soir
Une fleur de corail que le soleil arrose
C'est peut-être pour ça malgré ton rouge et noir
C'est peut-être pour ça qu'on te dit Ville Rose
Je revois ton pavé, ô ma cité gasconne
Ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz
Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne
Ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz ?
Voici le Capitole, j'y arrête mes pas
Les tenors enrhumés tremblent sous leurs ventouses
J'entends encore l'écho de la voix de papa
C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues
Aujourd'hui, tes buildings grimpent haut
A Blagnac, tes avions sont plus beaux
Si l'un me ramène sur cette ville
Pourrai-je encore y revoir ma pincée de tuiles
O moun païs, ô Toulouse, ô Toulouse
Jacques Brel
NE ME QUITTE PAS
Ne me quitte pas
Il faut oublier
Tout peut s'oublier
Qui s'enfuit déjà
Oublier le temps
Des malentendus
Et le temps perdu
A savoir comment
Oublier ces heures
Qui tuaient parfois
A coups de pourquoi
Le cœur du bonheur
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Moi je t'offrirai
Des perles de pluie
Venues de pays
Où il ne pleut pas
Je creuserai la terre
Jusqu'après ma mort
Pour couvrir ton corps
D'or et de lumière
Je ferai un domaine
Où l'amour sera roi
Où l'amour sera loi
Où tu sera reine
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Je t'inventerai
Des mots insensés
Que tu comprendras
Je te parlerai
De ces amants-là
Qui ont vu deux fois
Leurs cœurs s'embraser
Je te raconterai
Une histoire de ce roi
Mort de n'avoir pas
Pu te rencontrer
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
On a vu souvent
Rejaillir le feu
De l'ancien volcan
Qu'on croyait trop vieux
Il est paraît-d
Des terres brûlées
Donnant plus de blé
Qu'un meilleur avril
Et quand vient le soir
Pour qu'un ciel flamboie
Le rouge et le noir
Ne s'épousent-ils pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Je ne vais plus pleurer
Je ne vais plus parier
Je me cacherai là
A te regarder
Danser et sourire
Et à t'écouter
Chanter et puis rire
Laisse-moi devenir
L'ombre de ton ombre
Une ombre de ta main
Une ombre de ton chien
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
Ne me quitte pas
°°°°°°°°°°°
Le plat pays
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague
Et des vagues de dunes pour arrêter les vagues
Et de vagues rochers que les marées dépassent
Et qui ont à jamais le coeur à marée basse
Avec infiniment de brumes à venir
Avec le vent de l'est écoutez-le tenir
Le plat pays qui est le mien
Avec des cathédrales pour uniques montagnes
Et de noirs clochers comme mâts de cocagne
Où des diables en pierre décrochent les nuages
Avec le fil des jours pour unique voyage
Et des chemins de pluie pour unique bonsoir
Avec le vent d'ouest écoutez le vouloir
Le plat pays qui est le mien
Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu
Avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité
Avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu
Avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner
Avec le vent du nord qui vient s'écarteler
Avec le vent du nord écoutez-le craquer
Le plat pays qui est le mien
Avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut
Avec Frida la blonde quand elle devient Margot
Quand les fils de novembre nous reviennent en mai
Quand la plaine est fumante et tremble sous juillet
Quand le vent est au rire quand le vent est au blé
Quand le vent est au sud écoutez-le chanter
Le plat pays qui est le mien.
°°°°°°°°°°
Jacques Brel
Chansons
LITANIES POUR UN RETOUR
Mon cœur ma mie mon âme
Mon ciel mon feu ma flamme
Mon puits ma source mon val
Mon miel mon baume mon Graal
Mon blé mon or ma terre
Mon soc mon roc ma pierre
Ma nuit ma soif ma faim
Mon jour mon aube mon pain
Ma voile ma vague mon guide ma voie
Mon sang ma force ma fièvre mon moi
Mon chant mon rire mon vin ma joie
Mon aube mon cri ma vie ma foi
Mon cœur ma mie mon âme
Mon ciel mon feu ma flamme
Mon corps ma chair mon bien
Voilà que tu reviens.
Odilon-Jean PÉRIER (1901-1928)
Je ne chanterai pas très haut ni très longtemps
Je ne chanterai pas très haut ni très longtemps
Je ne chanterai pas très haut ni très longtemps.
C'est à mon plaisir seul, à vous que je m'attends
Égalité du cœur, honnête poésie.
Je n'ai rien de meilleur que cette humeur unie,
J'éprouve la couleur le grain de mon papier
Et l'incertain trésor que j'y viens gaspiller.
Toute pleine de moi, page sans bornes, vive
Étendue où respire une blanche captive,
Mon amour est sur toi comme un ciel éclairé.
Je me retrouve ici seul et désaltéré.
J'ai placé mon bonheur dans un calme langage :
J'aime, et jusqu'aux détours, la route où je m'engage.
Il est sur la cité cinq heures du matin
Dont les vapeurs de l'aube ont brouillé le dessin.
Déjà le boulanger quitte son four sonore,
La nuit aux marronniers, pâle, repose encore,
L'espace doucement a reçu les oiseaux
Et la sirène crie au milieu des bateaux.
Tout le gris éventail d'une ville éveillée
Ouvre son paysage au seuil de ma journée
Et parmi les couleurs de l'arrière-saison
Je dispose le monde autour de ma maison :
Ici d'humides toits glissent dans la lumière,
Se perd par la fumée une étoile dernière,
Un cerisier profond règne sur mon jardin
Et se charge de jour le gazon citadin.
Arbres, roses, pelouse, il n'est rien qui ressemble
A l'édifice pur que vous formez ensemble,
Mais combien difficile à ne point abîmer...
Le beau temps me baptise et fait son feu léger
Parcourir, éveiller un esprit sans faiblesse.
Le thé que je compose est philtre de sagesse,
L'eau tire de sa feuille une riche liqueur ;
J'en éprouve longtemps la pointe et la vigueur.
Ô Thé miraculeux dans cette porcelaine
Au prix d'un or si fin que la richesse est vaine !
Penché sur ton miroir comme les japonais
Respectueusement je respire la paix,
Je repose les mains sur une blanche table
Et le calme où je suis devient si délectable,
De si divine sorte et légèrement fait,
Que toute ma journée en sentira l'effet.
Cette chambre aux murs bleus ouvre dans le feuillage.
La vigne vierge y pousse une flamme sauvage,
Des meubles de bois sombre y luisent simplement
Et le corps est heureux de son embrassement,
Haute fenêtre d'or où ma ville s'appuie,
J'allume en votre honneur une pipe chérie :
Un feu doux et léger bouge au creux de la main,
Dont la chaleur me fait profondément humain.
J'écoute s'éveiller mille voix diligentes,
Battre les lourds tapis et chanter les servantes,
Bruxelles accomplir un rite matinal.
J'avance, l'air entier sonne comme un cristal
Et l'Automne guide mes pas aux avenues.
Pourtant il faut chanter les plus petites rues :
Du soleil s'abandonne à leur pâle pavé
Et le ciel alentour touchant et délavé.
Les marchandes de fleurs y cherchent un sourire ;
Elles ont la couleur des choses qu'on désire
Et, parmi le trésor le plus rafraîchissant
Vivantes, elles font un murmure glissant.
Dans sa robe d'argent comme une vieille amie
Voici pour mon repos la place Stéphanie,
Votre haute fontaine ô Porte de Namur,
Et les jardins du Roi pénétrés par l'azur.
Il est près de Midi. Je vois des hommes vivre.
Passe un cheval dansant, brillant comme le cuivre,
Une. petite fille aux magnifiques dents,
De célèbres messieurs, des cigares ardents.
Comme, au long des trottoirs, une bête docile,
Se range proprement la souple automobile ;
Des femmes sans couleur se tenant par la main
Avancent au milieu d'un silence inhumain.
Leurs cheveux sont ornés d'une rose glacée,
Cette blouse déteinte et leur lèvre blessée ;
Elles ne savent pas saluer le soleil.
Terrasse des cafés sous un lierre vermeil
D'où je vois s'agiter ma ville industrieuse,
Boulevard aussi beau par ta robe poudreuse
Qu'un fleuve déployé dans son vaste dessin,
Maisons de mes amis, la mienne, mon jardin,
Champs d'avoine et d'air pur qui faites la banlieue,
Nuages sur les toits et dans la pierre bleue,
Vous êtes le décor que je donne à ces vers.
Qui m'aime, aime ma ville et me suive au travers.
Dans le bois de la Cambre, un facile Dimanche,
Sous l'aile des pigeons cette île toute blanche,
Cette île, autour de quoi les feuillages et l'eau
Ferment dans le brouillard leur précieux anneau,
Ne vous est-elle pas, distraite citadine,
Comme, après le soleil, une pluie haute et fine
Nourriture du coeur et gage de santé ?
Mes rames dérangeant un trésor argenté,
La barque obéissante échappe à son sillage.
Vous êtes mon ami, sylvestre paysage,
Vous êtes la dernière et meilleure raison
De qui ne connaît plus le dieu de sa maison.
Mais déjà s'abandonne une image de rive
Au mouvement d'amour de cette onde attentive
Quand se répand sur elle et l'épouse le soir
Comme une jeune haleine obscurcit son miroir.
Déjà s'ouvrent, au fond d'un feuillage docile,
Les fleurs blêmes du gaz, les lampes de la ville ;
Une auréole tombe au pied d'arbres en feu,
Pâle et vaste, que j'aime, et qui m'égare un peu.
Adieu, domaine pur...
Bruxelles se déploie.
Une foire opulente alimente sa joie ;
Écumeuse comme elle et pleine de danger
Je regrette la mer, au moment d'y plonger.
Grosses roses de bois, carrousels de banlieue !
Un vertige saisit la fille en blouse bleue,
De tendres Grenadiers la soutiennent à point.
Un clown ouvre les bras, je lui souris de loin.
Je goûte ma faiblesse avec sollicitude,
Je me trouve, sans but et sans inquiétude,
A cette chaude foule un corps abandonné...
J'admire la souplesse et le bien-ordonné
D'une montagne russe au-dessus des feuillages :
Elle déroule un rail, visite les nuages,
Et chavire la foire ! et sombre ! et, mollement,
Berce, caresse, vide un corps convalescent...
Au front des promeneurs que cette foule mène
Au sommeil, aux plaisirs, goûtés sans trop de peine,
Le dangereux amour pose ses mains de feu ;
Et ses ruses feront la règle de mon jeu.
Je vous aime, Cité, domaine de la pluie,
Mais dont les habitants moquent la poésie.
Comme un grand violon de silence habité
Vous êtes l'instrument d'une divinité.
Laissez, laissez mûrir, se charger d'évidence
Cette chose sans nom, cette vaste espérance ;
Se composer un dieu par vos arbres blessés,
Par vos matins déserts et vos soleils brisés,
Par le visage d'or des nuits européennes.
A mes raisons d'amour chacun joigne les siennes.
Tant de silence frais, comme au petit matin,
Favorise le jeu d'un esprit citadin.
Quelle tranquillité fait ma fenêtre ouverte...
Bruxelles, arrosé comme une plante verte,
Bien nouveau, bien plaisant, se tait quand je le veux.
Ce n'est pas au hasard que je nomme ses dieux
Et ni distraitement que ce grand corps murmure.
Je sais où caresser ma belle sans-figure,
Ma ville habituée aux malices du ciel ;
Je ne souhaite pas de plaisir éternel :
Et les quatre saisons me gardent des surprises
Au filet du Printemps quand les branches sont prises
Et que de purs chemins traversent le gazon,
Comme un discours logique et nourri de raison
De beaux jardins me font une vertu nouvelle.
Mais, sous une toison brûlante et solennelle
Lorsque le mois de juin presse le boulevard,
Que des visages nus mélangent leur brouillard,
Autour de qui l'amour tourne comme une bête,
- Comment ne pas chérir cette rapide fête,
Comment ne pas se prendre aux pièges de l'Été ?
Octobre transparent a les couleurs du thé
Et cet intime accent qui fait d'un paysage
Aux hommes patients entendre le langage ;
La banlieue en Automne est un miroir secret
Qu'il faut longtemps polir et de mince reflet,
Mais qu'un peu d'amitié touche son eau fermée :
II n'est rien de si beau dans la plus belle année.
L'Hiver enfin m'enchante et le pavé sonnant ;
Bruxelles reformé dans un ordre émouvant,
Ses arbres dépouillés, sa menteuse logique,
Et le cruel éclat d'un ciel géométrique
Sur toutes nos maisons comme un couteau planté.
J'épuise ces trésors avec tranquillité.
Que n'importent des biens dont je n'ai plus envie
Si je n'en tire un miel qu'on nomme Poésie ?
Je compose ces vers pour me sentir vivant ;
Mais non pas au hasard, non pas distraitement.
Quel besoin de mentir, d'habiter un nuage ?
Il est assez de ruse en ce simple langage,
Les lecteurs que je veux ne s'y tromperont pas.
Yvonne aux gants de fil, dame des cinémas,
Perle et poudreuse rose à la faveur des ombres,
Voit Charlie au corps pur danser sur les décombres.
Les femmes n'aiment pas tant de légèreté.
Mais vous, plus attentive à la divinité,
Saisissez de ses jeux le périssable charme
Et comme un film usé me touche et me désarme,
Ainsi de vos cheveux, de votre froide main.
Mais Élise ! solide et comme le bon grain
Dorée, ouverte aux dieux, fondée en gymnastique,
Éprouve du talon la pelouse élastique
Touchée au petit jour par la grâce du sport.
D'où cette heureuse allure et ce paisible port.
De sommeillants bonheurs ne sauraient plus me plaire
Ni le goût de pain bis d'une enfant sédentaire ;
Mon Élise vivante a le coeur mieux placé,
Sous la douche reçoit un sacrement glacé
Et goûte ses plaisirs sans sourire ni plainte.
Mais toi, dont je chéris la fourrure déteinte
Quand remue à ton cou ce minable ornement,
Suzanne, à la clarté du gaz attendrissant,
Ivre, maigre, et m'ouvrant ta bouche apprivoisée,
Élève dans mes bras une chanson brisée
Ma ville et mon amie ont les mêmes yeux gris.
Sans doute est-il beaucoup de plus nobles pays,
De plus riches climats où déployer sa vie
(Et je ne sais, Paris, comme l'on vous oublie)
Paysages, lointains voyages, ciels changeants...
Mais trouverais-je ailleurs autant d'amis vivants ?
Ma patrie est où sont ces hommes délectables ;
C'est par eux que mes vers deviennent raisonnables,
Pour eux que je guéris d'un délire sacré ;
Ma ville obéissante est refaite à leur gré.
Heureux de parler clair, fondés en poésie,
Laissons-nous-y longtemps caresser par la vie :
Chaque jour de jeunesse est doré comme un pain ;
Poursuivons, sans vieillir, un dialogue humain.
Je termine à ces mots l'éloge de Bruxelles :
Poésie, Amitié, mes lois sont les plus belles,
Ornement du jardin, gloire de la maison,
Les précieux épis d'une riche saison.
Au terme aérien d'un jour sans aventure
Entre mes doigts s'achève un ouvrage d'eau pure
Et je baisse la voix, comme le soir se fait.
Que ma ville repose, elle a dit son secret :
Voici tout le dessin de son meilleur visage.
Comme la mer unit une facile plage,
Comme d'une amoureuse on lisse les cheveux,
Un instant sage encor, sage et silencieux,
Je contiens ma chanson, ma fortune ignorée...
Mais elle s'est de moi doucement détachée ;
Les mains vides, j'entends se perdre ses oiseaux...
Libre et seul, je connais le prix de mon repos :
Quelle paix sur ma ville et quel air d'innocence...
Mes vers portent en eux leur pure récompense.
| |
PIERRE EMMANUEL (1916-1984)
Dédicace d'Orphée
Me voici revenu de la rive incertaine
où lamente la lyre abandonnée d'Orphée :
le vent d'en-bas m'emplit de vertige les veines
et mon double brumeux ne s'est point dissipé.
Après avoir usé ma ressemblance humaine
les lunes mauves de l'Enfer m'ont patiné.
Mes yeux ? deux diamants d'hiver ou deux fontaines
Qui fixent un soleil immuable et glacé.
Tel l'arbre aux pas profonds, aveugle de murmures
secoue dans le sommeil ses nocturnes verdures
où les soleils défunts mûrissent oubliés :
Le même arbre de jour, que la lumière outrage
Sans feuilles, sans oiseaux, flagellant les nuages
Maudit de ses grands bras anathèmes l'été.
(Sodome édition du Seuil, 1953)
|
|
...........
|
Chapelle de la morte
La chapelle ancienne est fermée,
Et je refoule à pas discrets
Les dalles sonnant les regrets
De toute une ère parfumée.
Et je t'évoque, ô bien-aimée !
Épris de mystiques attraits :
La chapelle assume les traits
De ton âme qu'elle a humée.
Ton corps fleurit dans l'autel seul,
Et la nef triste est le linceul
De gloire qui te vêt entière ;
Et dans le vitrail, tes grands yeux
M'illuminent ce cimetière
De doux cierges mystérieux.
La passante
Hier, j'ai vu passer, comme une ombre qu'on plaint,
En un grand parc obscur, une femme voilée :
Funèbre et singulière, elle s'en est allée,
Recelant sa fierté sous son masque opalin.
Et rien que d'un regard, par ce soir cristallin,
J'eus deviné bientôt sa douleur refoulée ;
Puis elle disparut en quelque noire allée
Propice au deuil profond dont son cœur était plein.
Ma jeunesse est pareille à la pauvre passante :
Beaucoup la croiseront ici-bas dans la sente
Où la vie à la tombe âprement nous conduit;
Tous la verront passer, feuille sèche à la brise
Qui tourbillonne, tombe et se fane en la nuit ;
Mais nul ne l'aimera, nul ne l'aura comprise.
Ma mère
Quelquefois sur ma tête elle met ses mains pures,
Blanches, ainsi que des frissons blancs de guipures.
Elle me baise au front, me parle tendrement,
D'une voix au son d'or mélancoliquement.
Elle a les yeux couleur de ma vague chimère,
O toute poésie, ô toute extase, ô Mère !
A l'autel de ses pieds je l'honore en pleurant,
Je suis toujours petit pour elle, quoique grand.
Nuit d'été
Le violon, d'un chant très profond de tristesse,
Remplit la douce nuit, se mêle aux sons des cors,
Les sylphes vont pleurant comme une âme en détresse,
Et les cœurs des arbres ont des plaintes de morts.
Le souffle du Veillant anime chaque feuille ;
Aux amers souvenirs les bois ouvrent leur sein ;
Les oiseaux sont rêveurs ; et sous l'œil opalin
De la lune d'été ma Douleur se recueille...
Lentement, au concert que font sous la ramure
Les lutins endiablés comme ce Faust ancien,
Le luth dans tout mon cœur éveille en parnassien
La grande majesté de la nuit qui murmure
Dans les cieux alanguis un ramage lointain,
Prolongé jusqu'à l'aube, et mourant au Matin.
Sérénade triste
Comme des larmes d'or qui de mon cœur s'égouttent,
Feuilles de mes bonheurs, vous tombez toutes, toutes.
Vous tombez au jardin de rêve où je m'en vais,
Où je vais, les cheveux au vent des jours mauvais.
Vous tombez de l'intime arbre blanc, abattues
Çà et là, n'importe où, dans l'allée aux statues.
Couleur des jours anciens, de mes robes d'enfant,
Quand les grands vents d'automne ont sonné l'olifant.
Et vous tombez toujours, mêlant vos agonies,
Vous tombez, mariant, pâles, vos harmonies.
Vous avez chu dans l'aube au sillon des chemins,
Vous pleurez de mes yeux, vous tombez de mes mains.
Comme des larmes d'or qui de mon cœur s'égouttent,
Dans mes vingt ans déserts vous tombez toutes, toutes
Automne
Comme la lande est riche aux heures empourprées,
Quand les cadrans du ciel ont sonné les vesprées !
Quels longs effeuillements d'angélus par les chênes !
Quels suaves appels des chapelles prochaines !
Là-bas, groupes meuglant de grands bœufs aux yeux glauques
Vont menés par des gars aux bruyants soliloques.
La poussière déferle en avalanches grises
Pleines du chaud relent des vignes et des brises.
Un silence a plu dans les solitudes proches :
Des Sylphes ont cueilli le parfum mort des cloches.
Quelle mélancolie ! Octobre, octobre en voie !
Watteau ! que je vous aime, Autran, ô Millevoye !
...........
Charles Baudelaire
Maître, il est beau ton Vers ; ciseleur sans pareil,
Tu nous charmes toujours par ta grâce nouvelle,
Parnassien enchanteur du pays du soleil,
Notre langue frémit sous ta lyre si belle.
Les Classiques sont morts ; le voici le réveil ;
Grand Régénérateur, sous ta pure et vaste aile
Toute une ère est groupée. En ton vers de vermeil
Nous buvons ce poison doux qui nous ensorcelle.
Verlaine, Mallarmé sur ta trace ont suivi.
O Maître tu n'es plus mais tu vas vivre encore,
Tu vivras dans un jour pleinement assouvi.
Du Passé, maintenant, ton siècle ouvre un chemin
Où renaîtront les fleurs, perles de ton déclin.
Voilà la Nuit finie à l'éveil de l'Aurore.
...........
Chopin
Fais, au blanc frisson de tes doigts,
Gémir encore, ô ma maîtresse !
Cette marche dont la caresse
Jadis extasia les rois.
Sous les lustres aux prismes froids,
Donne à ce cœur sa morne ivresse,
Aux soirs de funèbre paresse
Coulés dans ton boudoir hongrois.
Que ton piano vibre et pleure,
Et que j'oublie avec toi l'heure
Dans un Eden, on ne sait où...
Oh ! fais un peu que je comprenne
Cette âme aux sons noirs qui m'entraîne
Et m'a rendu malade et fou !
............
Christ en croix
Je remarquais toujours ce grand Jésus de plâtre
Dressé comme un pardon au seuil du vieux couvent,
Échafaud solennel à geste noir, devant
Lequel je me courbais, saintement idolâtre.
Or, l'autre soir, à l'heure où le cri-cri folâtre,
Par les prés assombris, le regard bleu rêvant,
Récitant Eloa, les cheveux dans le vent,
Comme il sied à l'Éphèbe esthétique et bellâtre,
J'aperçus, adjoignant des débris de parois,
Un gigantesque amas de lourde vieille croix
Et de plâtre écroulé parmi les primevères ;
Et je restai là, morne, avec les yeux pensifs,
Et j'entendais en moi des marteaux convulsifs
Renfoncer les clous noirs des intimes Calvaires.
...........
Dans l'allée
Toi-même, éblouissant comme un soleil ancien
Les Regrets des solitudes roses,
Contemple le dégât du Parc magicien
Où s'effeuillent, au pas du Soir musicien,
Des morts de camélias, de roses.
Revisitons le Faune à la flûte fragile
Près des bassins au vaste soupir,
Et le banc où, le soir, comme un jeune Virgile,
Je venais célébrant sur mon théorbe agile
Ta prunelle au reflet de saphir.
La Nuit embrasse en paix morte les boulingrins,
Tissant nos douleurs aux ombres brunes,
Tissant tous nos ennuis, tissant tous nos chagrins,
Mon cœur, si peu quiet qu'on dirait que tu crains
Des fantômes d'anciennes lunes !
Foulons mystérieux la grande allée oblique ;
Là, peut-être à nos appels amis
Les Bonheurs dresseront leur front mélancolique,
Du tombeau de l'Enfance où pleure leur relique,
Au recul de nos ans endormis.
...........
Le talisman
Pour la lutte qui s'ouvre au seuil des mauvais jours,
Ma mère m'a fait don d'un petit portrait d'elle,
Un gage auquel je suis resté depuis fidèle
Et qu'à mon cou suspend un cordon de velours.
" Sur l'autel de ton cœur, puisque la Mort m'appelle,
Enfant, m'a-t-elle dit, je veillerai toujours.
Que ceci chasse au loin les funestes amours,
Comme un lampion d'or, gardien d'une chapelle. "
Ah ! sois tranquille en les ténèbres du cercueil !
Ce talisman sacré de ma jeunesse en deuil
Préservera ton fils des bras de la Luxure,
Tant j'aurais peur de voir un jour sur ton portrait
Couler de tes yeux doux les pleurs d'une blessure,
Mère !... et dont je mourrais, plein d'éternel regret.
............
Premier remords
Au temps où je portais des habits de velours,
Éparses sur mon col roulaient mes boucles brunes.
J'avais de grands yeux purs comme le clair des lunes ;
Dès l'aube je partais, sac au dos, les pas lourds.
Mais en route aussitôt je tramais des détours,
Et, narguant les pions de mes jeunes rancunes,
Je montais à l'assaut des pommes et des prunes
Dans les vergers bordant les murailles des cours.
Étant ainsi resté loin des autres élèves,
Loin des bancs, tout un mois, à vivre au gré des rêves,
Un soir, à la maison, craintif, comme j'entrais,
Devant le crucifix où sa lèvre se colle
Ma mère était en pleurs !... O mes ardents regrets !
Depuis, je fus toujours le premier à l'école.
°°°°°°°°°°°
Poème écrit à Dachau, attribué au pasteur Martin Niemöller.
Quand ils sont venus
chercher les juifs
je n'ai rien dit
je n'étais pas juif
Quand ils sont venus
chercher les catholiques
je n'ai rien dit
je n'étais pas catholique
Quand ils sont venus
chercher les communistes
je n'ai rien dit
je n'étais pas communiste
Quand ils sont venus
chercher les syndicalistes
je n'ai rien dit
je n'étais pas syndicaliste
Puis ils sont venus me chercher
Et il ne restait plus personne pour protester.
°°°°°°°°°°°
Henri Michaux (1899-1984)
Ma Vie
Tu t'en vas sans moi, ma vie.
Tu roules.
Et moi j'attends encore de faire un pas.
Tu portes ailleurs la bataille.
Tu me désertes ainsi.
Je ne t'ai jamais suivie.
Je ne vois pas clair dans tes offres.
Le petit peu que je veux, jamais tu ne l'apportes.
A cause de ce manque, j'aspire à tant.
A tant de choses, à presque l'infini...
A cause de ce peu qui manque, que jamais tu n'apportes.
Extrait de "La Nuit Remue" Poésie/Gallimard
Petit
Quand vous me verrez,
Allez,
Ce n'est pas moi.
Dans les grains de sable,
Dans les grains des grains,
Dans la farine invisible de l'air,
Dans le grand vide qui se nourrit comme du sang,
C'est là que je vis.
Oh ! je n'ai pas à me vanter : Petit ! petit !
Et si l'on me tenait,
On ferait de moi ce qu'on voudrait.
Le nuit remue Editions Gallimard
Le grand combat
Il l'emparouille et l'endosque contre terre ;
Il le rague et le roupéte jusqu'à son drâle ;
Il le pratéle et le libucque et lui baroufle les ouillais ;
Il le tocarde et le marmine,
Le manage rape à ri et ripe à ra.
Enfin il l'écorcobalisse.
L'autre hésite, s'espudrine, se défaisse, se torse et se ruine.
C'en sera bientôt fini de lui ;
Il se reprise et s'emmargine... mais en vain
Le cerveau tombe qui a tant roulé.
Abrah ! Abrah ! Abrah !
Le pied a failli !
Le bras a cassé !
Le sang a coulé !
Fouille, fouille, fouille,
Dans la marmite de son ventre est un grand secret.
Mégères alentours qui pleurez dans vos mouchoirs ;
On s'étonne, on s'étonne, on s'étonne
Et on vous regarde,
On cherche aussi, nous autres le Grand Secret.
°°°°°°°°°°°
Paul Géraldy
LA FOURMI
Une fourmi de dix-huit mètres
Avec un chapeau sur la tête,
Ça n'existe pas, ça n'existe pas.
Une fourmi traînant un char
Plein de pingouins et de canards,
Ça n'existe pas, ça n'existe pas.
Une fourmi parlant français
Parlant latin et javanais,
Ça n'existe pas, ça n'existe pas.
Eh! Pourquoi pas ?
Absence
Ce n'est pas dans le moment
où tu pars que tu me quittes.
Laisse-moi, va, ma petite,
il est tard, sauve-toi vite !
Plus encor que tes visites
j'aime leurs prolongements.
Tu m'es plus présente, absente.
Tu me parles. Je te vois.
Moins proche, plus attachante,
moins vivante, plus touchante,
tu me hantes, tu m'enchantes !
Je n'ai plus besoin de toi.
Mais déjà pâle, irréelle,
trouble, hésitante, infidèle,
tu te dissous dans le temps.
Insaisissable, rebelle,
tu m'échappes, je t'appelle.
Tu me manques, je t'attends !
| |
La dormeuse
Figure de femme, sur son sommeil
fermée, on dirait qu'elle goûte
quelque bruit à nul autre pareil
qui la remplit toute.
De son corps sonore qui dort
elle tire la jouissance
d'être un murmure encor
sous le regard du silence
Rainer Maria RILKE
1875-1926
|
|
Paul Eluard
1895 - 1952
La bouche
aux lèvres d'or
n'est pas en moi pour rire
et tes mots d'auréoles
ont un sens si parfait
que de mes nuits damnées
de silences et de morts
j'entends vibrer ta voix
dans toutes les nuits du monde
LIBERTÉ
Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J'écris ton nom
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J'écris ton nom
Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J'écris ton nom
Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l'écho de mon enfance
J'écris ton nom
Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons fiancées
J'écris ton nom
Sur tous mes chiffons d'azur
Sur l'étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J'écris ton nom
Sur les champs sur l'horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J'écris ton nom
Sur chaque bouffée d'aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J'écris ton nom
Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l'orage
Sur la pluie épaisse et fade
J'écris ton nom...
Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J'écris ton nom
Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J'écris ton nom
Sur l'absence sans désirs
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J'écris ton nom
Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l'espoir sans souvenir
J'écris ton nom
Et par le pouvoir d'un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
LIBERTÉ
Bonne justice
C'est la chaude loi des hommes
Du raisin ils font du vin
Du charbon ils font du feu
Des baisers ils font des hommes.
C'est la dure loi des hommes
Se garder intact malgré
Les guerres et la misère
Malgré les dangers de mort.
C'est la douce loi des hommes
De changer l'eau en lumière
Le rêve en réalité
Et les ennemis en frères.
Une loi vieille et nouvelle
Qui va se perfectionnant
Du fond du cœur de l'enfant
Jusqu'a la raison suprême.
&
& & & &
|
Robert Desnos
1900 - 1945
Je
suis le veilleur de la rue de Flandre,
Je veille tandis que dort Paris.
Vers le nord un incendie lointain
rougeoie dans la nuit.
J'entends passer des avions
au-dessus de la ville.
Je
suis le veilleur du Point du Jour.
La Seine se love dans l'ombre, ...
... derrière
le viaduc d'Auteuil,
Sous
vingt-trois ponts à travers Paris.
Vers l'ouest j'entends des explosions.
Je suis le
veilleur de la Porte Dorée.
Autour du donjon le bois de Vincennes
épaissit ...
... ses ténèbres.
J'ai entendu des cris dans la direction de Créteil
Et des trains roulent vers l'est avec
un sillage ...
... de chants de révolte.
Je suis le veilleur de la Poterne des
Peupliers.
Le vent du sud m'apporte une fumée âcre,
Des rumeurs incertaines et des râles
Qui se dissolvent, quelque part, dans
Plaisance ...
...ou Vaugirard.
Au sud, au nord, à l'est, à l'ouest,
Ce ne sont que fracas de guerre
convergeant vers Paris.
Ai-je
vraiment vécu trente-six années ?
Ce n'est pas hier que mes souvenirs
que mes rêves mes amours se sont passés
c'est aujourd'hui
Le balcon de la rue Saint-Martin
la boutique où je regardais des éponges
poussiéreuses
Les temples du quai
Tout cela est encore là
mais
surtout
Je sens encore beaucoup d'années à
venir
Et beaucoup de choses à faire
Devant moi.
Dans
les trémies du ciel
un archange nage, comme il sied, vers
une usine.
Faux-monnayeurs que faites-vous de mes
ongles ?
J'ai lu dans le journal un roman dont
j'étais le héros
toujours à l'aise quand il fait pluie.
Mon coeur bat l'extinction des feux,
Mes yeux sont la nuit.
Je veille mes lendemains avec anxiété.
Au bout d'un an et deux jours...
alors il se fit une journée de pluie
d'or ...
... et les sept phares
merveilleux
du monde...
Escadres souterraines ne vous approchez
...
... pas de mon tombeau :
Je suis employé à déclouer les vieux
cercueils
pour répartir équitablement les
ossements
entre les anciennes sépultures
et les neuves.
Quelle profession ? Profession de foi ...
tu ne figures pas au Bottin.
Les photographes rougiraient si vous
les
regardiez en pleurant.
Je suis un mort de fraîche date.
Si vous rencontrez un corbillard déchaussez-vous,
Cela fera du bien au mort.
Il se lèvera,
il se sortira,
il chantera,
il chantera la chanson des quadrilles
et dans le futur on verra les nouveau-nés
...
... arriver au monde
escortés de squelettes.
Ce ne seront partout que grossesses de
géantes,
Il sera de bon ton chez les élégantes
de faire monter en bague
les larmes solides des morts à
l'occasion ...
... des naissances.
Amour haut parleur, sirène à corps d'oiseau,
je vous quitte.
Je vais goûter le silence cette belle
algue ...
... où dorment les requins.
|

Votez Robert Desnos
|
Saint-John Perse
1887 - 1975
Berceuse
Première-Née - temps de l'oriole,
Première-Née - le mil en fleurs,
Et tant de flûtes aux cuisines...
Mais le chagrin au coeur des Grands
Qui n'ont que filles à leur arc.
S'assembleront les gens de guerre,
Et tant de sciences aux terrasses...
Première-Née, chagrin du peuple,
Les dieux murmurent aux citernes,
Se taisent les femmes aux cuisines.
Gênait les prêtres et leurs filles,
Gênait les gens de chancellerie
Et les calculs de l'astronome :
"Dérangerez-vous l'ordre et le rang?"
Telle est l'erreur à corriger.
Du lait de Reine tôt sevrée,
Au lait d'euphorbe tot vouée,
Ne ferez plus la moue des Grands
Sur le miel et sur le mil,
Sur la sébile des vivants...
L'ânier pleurait sous les lambris,
Oriole en main, cigale en l'autre :
"Mes jolies cages, mes jolies cages,
Et l'eau de neige de mes outres,
Ah! pour qui donc, fille des Grands ?"
Fut embaumée, fut lavée d'or,
Mise au tombeau dans les pierres noires :
En lieu d'agaves, de beau temps,
Avec ses cages à grillons
Et le soleil d'ennui des Rois.
S'en fut l'ânier, s'en vint le Roi !
"Qu'on peigne la chambre d'un ton vif
Et la fleur mâle au front des Reines..."
J'ai fait ce rêve, dit l'oriole,
D'un cent de reines en bas âge.
Pleurez, l'ânier, chantez l'oriole,
Les filles closes dans les jarres
Comme cigales dans le miel,
Les flûtes mortes aux cuisines
Et tant de sciences aux terrasses.
N'avait qu'un songe et qu'un chevreau
- Fille et chevreau de même lait -
N'avait l'amour que d'une Vieille.
Ses caleçons d'or furent au Clergé,
Ses guimpes blanches à la Vieille...
Très vieille femme de balcon
Sur sa berceuse de rotin,
Et qui mourra de grand beau temps
Dans le faubourg d'argile verte...
"Chantez, ô Rois, les fils à naître!"
Aux salles blanches comme semoule
Le Scribe range ses pains de terre.
L'ordre reprend dans les grands Livres.
Pour l'oriole et le chevreau,
Voyez le Maître des cuisines.
&
& & & &
Le Sylphe,
Paul Valéry
Ni vu ni connu
Je suis le parfum
Vivant et défunt
Dans le vent venu !
Ni vu ni connu
Hasard ou génie ?
A peine venu
La tâche est finie
Ni lu ni compris ?
Aux meilleurs esprits
Que d'erreurs promises !
Ni vu ni connu,
Le temps d'un sein nu
Entre deux chemises
&
& & & &
Alain Grandbois,
poète Québécois, né le 25 mai 1900
Que la nuit
soit parfaite.
Que la nuit soit parfaite si nous en sommes dignes
Nulle pierre blanche ne nous indiquait la route
Où les faiblesses vaincues achevaient de mourir
Nous allions plus loin que les plus lointains horizons
Avec nos épaules et nos mains
Et cet élan pareil
Aux étincelles des insondables voûtes
Et cette faim de durer
Et cette soif de souffrir
Nous étouffant au cou
Comme mille pendaisons
Nous avons partagé nos ombres
Plus que nos lumières
Nous nous sommes montrés
Plus glorieux de nos blessures
Que des victoires éparses
Et des matins heureux
Et nous avons construit mur à mur
La noire enceinte de nos solitudes
Et ces chaînes de fer rivées à nos chevilles
Forgées du métal le plus dur
Que parfaite soit la nuit où nous nous enfonçons
Nous avons détruit tout bonheur et toute tendresse
Et nos cris désormais
N'auront plus que le tremblant écho
Des poussières perdues
Aux gouffres des néants
GRANDBOIS, Alain, Les îles de la nuit, Éditions de l'Hexagone, 1963.
&
& & & &
MOTS AU QUOTIDIEN...
Proposé par Angèle, auteur inconnu
les mots de tous les jours
ne portent ni veston ni cravate
ils dépeignent le quotidien
ils parlent de sentiments
de caresses et d'affection
ils tapent sur l'épaule
du copain qui est dans le pétrin
qui a besoin de compréhension
ils lui disent les mots qu'il faut
et ils versent avec compassion du baume
sur les plaies qui marquent sa peau
sans se prendre pour des acrobates
les mots sourient aussi à la vie
ils leur arrivent de faire les bouffons
de marcher les pattes en l'air
ils s'esclaffent et rigolent
ils racontent des blagues
souvent même assez polissonnes
s'expriment sans faire de détours
sur le sexe et la drague
ils s'amusent à jouer des tours
sans prendre les choses trop au sérieux
mais les mots comme va le vent
vite changent de direction
virent de tribord à bâbord
deviennent tantôt tristes
avec des accents mélancoliques
tantôt ils sont remplis d'angoisse
affichent des visages affligés
parfois avec gène ils bafouillent
ne savent plus trop quoi dire
alors tout piteux ils se taisent
leurs silences éloquents en disent long
à d'autres moments leur ton est lyrique
ils s'enfilent comme des perles
et s'alignent pour former des vers
qui disent avec plus de douceur
l'amour que l'on n'ose déclarer tout haut
ils prononcent tout bas les déclarations
de l'amoureux transi à sa bien-aimée
et quand ils deviennent muets
ce n'est pas parce qu'ils bougonnent
c'est qu'ils n'ont plus rien à dire
et que dans le dictionnaire ils dorment
(Auteur inconnu)
André Breton
Tournesol
La voyageuse qui traverse les Halles à la tombée de l'été
Marchait sur la pointe des pieds
Le désespoir roulait au ciel ses grands arums si beaux
Et dans le sac à main il y avait mon rêve ce flacon de sels
Que seule a respiré la marraine de Dieu
Les torpeurs se déployaient comme la buée
Au Chien qui fume
Ou venaient d'entrer le pour et le contre
La jeune femme ne pouvait être vue d'eux que mal et de biais
Avais-je affaire à l'ambassadrice du salpêtre
Ou de la courbe blanche sur fond noir que nous appelons pensée
Les lampions prenaient feu lentement dans les marronniers
La dame sans ombre s'agenouilla sur le Pont au change
Rue Git-le-Coeur les timbres n'étaient plus les mêmes
Les promesses de nuits étaient enfin tenues
Les pigeons voyageurs les baisers de secours
Se joignaient aux seins de la belle inconnue
Dardés sous le crêpe des significations parfaites
Une ferme prospérait en plein Paris
Et ses fenêtres donnaient sur la voie lactée
Mais personne ne l'habitait encore à cause des survenants
Des survenants qu'on sait plus dévoués que les revenants
Les uns comme cette femme ont l'air de nager
Et dans l'amour il entre un peu de leur substance
Elle les intériorise
Je ne suis le jouet d'aucune puissance sensorielle
Et pourtant le grillon qui chantait dans les cheveux de cendres
Un soir près de la statue d'Etienne Marcel
M'a jeté un coup d'œil d'intelligence
André Breton a-t-il dit passe
|

|
Jacques Prevert
La grasse matinée
Il est terrible
le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain
il est terrible ce bruit
quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim
elle est terrible aussi la tête de l'homme
la tête de l'homme qui a faim
quand il se regarde à six heures du matin
dans la glace du grand magasin
une tête couleur de poussière
ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde
dans la vitrine de chez Potin
il s'en fout de sa tête l'homme
il n'y pense pas
il songe
il imagine une autre tête
une tête de veau par exemple
avec une sauce de vinaigre
ou une tête de n'importe quoi qui se mange
et il remue doucement la mâchoire
doucement
et il grince des dents doucement
car le monde se paye sa tête
et il ne peut rien contre ce monde
et il compte sur ses doigts un deux trois
un deux trois
cela fait trois jours qu'il n'a pas mangé
et il a beau se répéter depuis trois jours
Ça ne peut pas durer
ça dure
trois jours
trois nuits
sans manger
et derrière ces vitres
ces pâtés ces bouteilles ces conserves
poissons morts protégés par les boîtes
boîtes protégées par les vitres
vitres protégées par les flics
flics protégés par la crainte
que de barricades pour six malheureuses sardines...
Un peu plus loin le bistro
café-crème et croissants chauds
l'homme titube
et dans l'intérieur de sa tête
un brouillard de mots
un brouillard de mots
sardines à manger
oeuf dur café-crème
café arrosé rhum
café-crème
café-crème
café-crime arrosé sang !...
Un homme très estimé dans son quartier
a été égorgé en plein jour
l'assassin le vagabond lui a volé
deux francs
soit un café arrosé
zéro franc soixante-dix
deux tartines beurrées
et vingt-cinq centimes pour le pourboire deu garçon.
Il est terrible
le petit bruit de l'oeuf dur cassé sur un comptoir d'étain
il est terrible ce bruit
quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim.
Les enfants qui s'aiment
Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout
Contre les portes de la nuit
Et les passants qui passent les désignent du doigt
Mais les enfants qui s'aiment
Ne sont là pour personne
Et c'est seulement leur ombre
Qui tremble dans la nuit
Excitant la rage des passants
Leur rage leur mépris leurs rires et leur envie
Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne
Ils sont ailleurs bien plus loin que la nuit
Bien plus haut que le jour
Dans l'éblouissante clarté de leur premier amour.
Jacques Prevert
N'hésitez
pas, ils sont nos contemporains ! Clic !
Dernière mise à jour : jeudi 17 juin 2004
Marcel
Proust (1871-1922) (recueil: Poèmes)
Je contemple souvent le ciel de ma mémoire
Le temps efface tout comme effacent les vagues
Les travaux des enfants sur le sable aplani
Nous oublierons ces mots si précis et si vagues
Derrière qui chacun nous sentions l'infini.
Le temps efface tout il n'éteint pas les yeux
Qu'ils soient d'opale ou d'étoile ou d'eau claire
Beaux comme dans le ciel ou chez un lapidaire
Ils brûleront pour nous d'un feu triste ou joyeux.
Les uns joyaux volés de leur écrin vivant
Jetteront dans mon cœur leurs durs reflets de pierre
Comme au jour où sertis, scellés dans la paupière
Ils luisaient d'un éclat précieux et décevant.
D'autres doux feux ravis encor par Prométhée
Étincelle d'amour qui brillait dans leurs yeux
Pour notre cher tourment nous l'avons emportée
Clartés trop pures ou bijoux trop précieux.
Constellez à jamais le ciel de ma mémoire
Inextinguibles yeux de celles que j'aimai
Rêvez comme des morts, luisez comme des gloires
Mon cœur sera brillant comme une nuit de Mai.
L'oubli comme une brume efface les visages
Les gestes adorés au divin autrefois,
Par qui nous fûmes fous, par qui nous fûmes sages
Charmes d'égarement et symboles de foi.
Le temps efface tout l'intimité des soirs
Mes deux mains dans son cou vierge comme la neige
Ses regards caressants mes nerfs comme un arpège
Le printemps secouant sur nous ses encensoirs.
D'autres, les yeux pourtant d'une joyeuse femme,
Ainsi que des chagrins étaient vastes et noirs
Épouvante des nuits et mystère des soirs
Entre ces cils charmants tenait toute son âme
Et son cœur était vain comme un regard joyeux.
D'autres comme la mer si changeante et si douce
Nous égaraient vers l'âme enfouie en ses yeux
Comme en ces soirs marins où l'inconnu nous pousse.
Mer des yeux sur tes eaux claires nous naviguâmes
Le désir gonflait nos voiles si rapiécées
Nous partions oublieux des tempêtes passées
Sur les regards à la découverte des âmes.
Tant de regards divers, les âmes si pareilles
Vieux prisonniers des yeux nous sommes bien déçus
Nous aurions dû rester à dormir sous la treille
Mais vous seriez parti même eussiez-vous tout su
Pour avoir dans le cœur ces yeux pleins de promesses
Comme une mer le soir rêveuse de soleil
Vous avez accompli d'inutiles prouesses
Pour atteindre au pays de rêve qui, vermeil,
Se lamentait d'extase au-delà des eaux vraies
Sous l'arche sainte d'un nuage cru prophète
Mais il est doux d'avoir pour un rêve ces plaies
Et votre souvenir brille comme une fête.
Les Yeux d'Elsa Louis Aragon
Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire
J'ai vu tous les soleils y venir se mirer
S'y jeter à mourir tous les désespérés
Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire
À l'ombre des oiseaux c'est l'océan troublé
Puis le beau temps soudain se lève et tes yeux changent
L'été taille la nue au tablier des anges
Le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les blés
Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur
Tes yeux plus clairs que lui lorsqu'une larme y luit
Tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie
Le verre n'est jamais si bleu qu'à sa brisure
Mère des Sept douleurs ô lumière mouillée
Sept glaives ont percé le prisme des couleurs
Le jour est plus poignant qui point entre les pleurs
L'iris troué de noir plus bleu d'être endeuillé
Tes yeux dans le malheur ouvrent la double brèche
Par où se reproduit le miracle des Rois
Lorsque le coeur battant ils virent tous les trois
Le manteau de Marie accroché dans la crèche
Une bouche suffit au mois de Mai des mots
Pour toutes les chansons et pour tous les hélas
Trop peu d'un firmament pour des millions d'astres
Il leur fallait tes yeux et leurs secrets gémeaux
L'enfant accaparé par les belles images
Écarquille les siens moins démesurément
Quand tu fais les grands yeux je ne sais si tu mens
On dirait que l'averse ouvre des fleurs sauvages
Cachent-ils des éclairs dans cette lavande où
Des insectes défont leurs amours violentes
Je suis pris au filet des étoiles filantes
Comme un marin qui meurt en mer en plein mois d'août
J'ai retiré ce radium de la pechblende
Et j'ai brûlé mes doigts à ce feu défendu
Ô paradis cent fois retrouvé reperdu
Tes yeux sont mon Pérou ma Golconde mes Indes
Il advint qu'un beau soir l'univers se brisa
Sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent
Moi je voyais briller au-dessus de la mer
Les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa les yeux d'Elsa
La nuit de Dunkerque
La France sous nos pied comme une étoffe usée
S'est petit à petit à nos pas refusée
Dans la mer où les morts se mêlent aux varechs
Les bateaux renversés font des bonnets d'évêque
Bivouac à cent mille au bord du ciel et l'eau
Prolonge dans le ciel la plage de Malo
Il monte dans le soir où des chevaux pourrissent
Comme un piétinement de bêtes migratrices
Le passage à niveaux lève ses bras rayés
Nous retrouvons nos cœurs en nous dépareillés
Cent mille amours battant aux cœurs des Jean sans terre
Vont-ils à tout jamais cent mille fois se taire
O saint Sébastien que la vie a criblés
Que vous me ressemblez que vous me ressemblez
Sûr que seuls m'entendront ce qui la faiblesse eurent
De toujours à leur cœur préférer sa blessure
Moi du moins je crierai cet amour que je dis
Dans la nuit on voit mieux les fleurs de l'incendie
Je crierai je crierai dans la ville qui brûle
A faire chavirer des toits les somnambules
Je crierai mon amour comme le matin tôt
Le rémouleur passant chantant Couteaux Couteaux
Je crierai je crierai Mes yeux que j'aime où êtes-
Vous où es-tu mon alouette ma mouette
Je crierai je crierai plus fort que les obus
Que ceux qui sont blessés et que ceux qui ont bu
Je crierai je crierai Ta lèvre est le verre où
J'ai bu le long amour ainsi que du vin rouge
Le lierre de tes bras à ce monde me lie
Je ne peux pas mourir Celui qui meurt oublie
Je me souviens des yeux de ceux qui s'embarquèrent
Qui pourrait oublier son amour à Dunkerque
Je ne peux pas dormir à cause des fusées
Qui pourrait oublier l'alcool qui l'a grisé
Les soldats ont creusé des trous grandeur nature
Et semblent essayer l'ombre des sépultures
Visages de cailloux Postures de déments
Leur sommeil a toujours l'air d'un pressentiment
Les parfums du printemps le sable les ignore
Voici mourir le Mai dans les dunes du Nord
Louis Aragon
PAUL GERALDY
1885 -
Abat-jour
Tu demandes pourquoi je reste sans rien dire ?
C'est que voici le grand moment,
l'heure des yeux et du sourire,
le soir, et que ce soir je t'aime infiniment !
Serre-moi contre toi. J'ai besoin de caresses.
Si tu savais tout ce qui monte en moi, ce soir,
d'ambition, d'orgueil, de désir, de tendresse, et de bonté !...
Mais non, tu ne peux pas savoir !...
Baisse un peu l'abat-jour, veux-tu ? Nous serons mieux.
C'est dans l'ombre que les coeurs causent,
et l'on voit beaucoup mieux les yeux
quand on voit un peu moins les choses.
Ce soir je t'aime trop pour te parler d'amour.
Serre-moi contre ta poitrine!
Je voudrais que ce soit mon tour d'être celui que l'on câline...
Baisse encore un peu l'abat-jour.
Là. Ne parlons plus. Soyons sages.
Et ne bougeons pas. C'est si bon
tes mains tièdes sur mon visage!...
Mais qu'est-ce encor ? Que nous veut-on ?
Ah! c'est le café qu'on apporte !
Eh bien, posez ça là, voyons !
Faites vite!... Et fermez la porte !
Qu'est-ce que je te disais donc ?
Nous prenons ce café... maintenant ? Tu préfères ?
C'est vrai : toi, tu l'aimes très chaud.
Veux-tu que je te serve? Attends! Laisse-moi faire.
Il est fort, aujourd'hui. Du sucre? Un seul morceau?
C'est assez? Veux-tu que je goûte?
Là! Voici votre tasse, amour...
Mais qu'il fait sombre. On n'y voit goutte.
Lève donc un peu l'abat-jour.
Paul Géraldy.
La Rose et le
Réséda
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Tous deux adoraient la belle
Prisonnière des soldats
Lequel montait à l'échelle
Et lequel guettait en bas
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Qu'importe comment s'appelle
Cette clarté sur leur pas
Que l'un fut de la chapelle
Et l'autre s'y dérobât
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Tous les deux étaient fidèles
Des lèvres du coeur des bras
Et tous les deux disaient qu'elle
Vive et qui vivra verra
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Quand les blés sont sous la grêle
Fou qui fait le délicat
Fou qui songe à ses querelles
Au coeur du commun combat
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Du haut de la citadelle
La sentinelle tira
Par deux fois et l'un chancelle
L'autre tombe qui mourra
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Ils sont en prison Lequel
A le plus triste grabat
Lequel plus que l'autre gèle
Lequel préfère les rats
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Un rebelle est un rebelle
Deux sanglots font un seul glas
Et quand vient l'aube cruelle
Passent de vie à trépas
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Répétant le nom de celle
Qu'aucun des deux ne trompa
Et leur sang rouge ruisselle
Même couleur même éclat
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
Il coule il coule il se mêle
À la terre qu'il aima
Pour qu'à la saison nouvelle
Mûrisse un raisin muscat
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n'y croyait pas
L'un court et l'autre a des ailes
De Bretagne ou du Jura
Et framboise ou mirabelle
Le grillon rechantera
Dites flûte ou violoncelle
Le double amour qui brûla
L'alouette et l'hirondelle
La rose et le réséda
...........
Le modeste
(Poème de Louis Aragon)
Les pays, c'est pas ça qui manque,
On vient au monde à Salamanque
A Paris, Bordeaux, Lille, Brest(e).
Lui, la nativité le prit
Du côté des Saintes-maries,
C'est un modeste.
Comme jadis a fait un roi,
Il serait bien fichu, je crois,
De donner le trône et le reste
Contre un seul cheval camarguais
Bancal, vieux, borgne, fatigué,
C'est un modeste.
Suivi de son pin parasol,
S'il fuit sans mêm' toucher le sol
Le moindre effort comme la peste,
C'est qu'au chantier ses bras d'Hercule
Rendraient les autres ridicules,
C'est un modeste.
A la pétanque, quand il perd
Te fais pas de souci, pépère,
Si d'aventure il te conteste.
S'il te boude, s'il te rudoie,
Au fond, il est content pour toi,
C'est un modeste.
Si, quand un emmerdeur le met
En rogne, on ne le voit jamais
Lever sur l'homme une main leste.
C'est qu'il juge pas nécessaire
D'humilier un adversaire,
C'est un modeste.
Et quand il tombe amoureux fou
Y a pas de danger qu'il l'avoue
Les effusions, dame, il déteste.
Selon lui, mettre en plein soleil
Son cœur ou son cul c'est pareil,
C'est un modeste.
Quand on enterre un imbécile
De ses amis, s'il raille, s'il
A l'œil sec et ne manifeste
Aucun chagrin, t'y fie pas trop:
Sur la patate, il en a gros,
C'est un modeste.
Et s'il te traite d'étranger
Que tu sois de Naples, d'Angers
Ou d'ailleurs, remets pas la veste.
Lui, quand il t'adopte, pardi!
Il veut pas que ce soit le dit,
C'est un modeste.
Si tu n'as pas tout du grimaud,
Si tu sais lire entre les mots,
Entre les faits, entre les gestes.
Lors, tu verras clair dans son jeu,
Et que ce bel avantageux,
C'est un modeste.
°°°°°°°°°°°
LA PAROLE, Paul Eluard
J'ai la beauté facile et c'est heureux.
Je glisse sur les toits des vents
Je glisse sur le toit des mers
Je suis devenue sentimentale
Je ne connais plus le conducteur
Je ne bouge plus soie sur les glaces
Je suis malade fleurs et cailloux
J'aime le plus chinois aux nues
J'aime la plus nue aux écarts d'oiseau
Je suis vieille mais ici je suis belle
Et l'ombre qui descend des fenêtres profondes
Épargne chaque soir le cœur noir de mes yeux
...........
L'AMOUREUSE Paul ELUARD
Elle est debout sur mes paupières
Et ses cheveux sont dans les miens,
Elle a la forme de mes mains,
Elle a la couleur de mes yeux,
Elle s'engloutit dans mon ombre
Comme une pierre sur le ciel.
Elle a toujours les yeux ouverts
Et ne me laisse pas dormir.
Ses rêves en pleine lumière
Font s'évaporer les soleils
Me font rire, pleurer et rire,
Parler sans avoir rien à dire.
...........